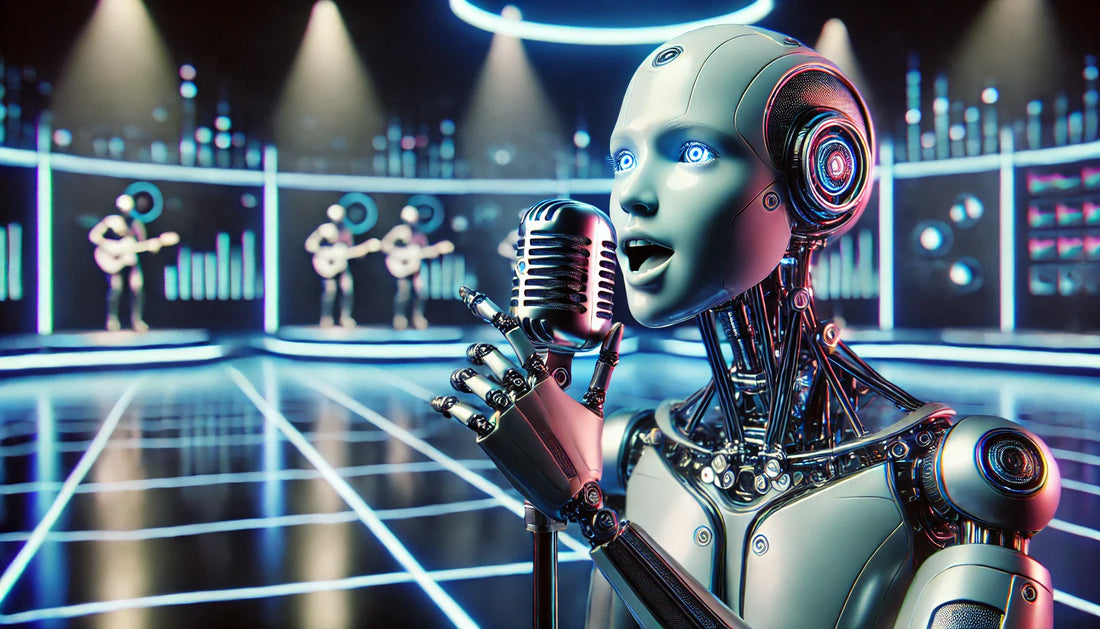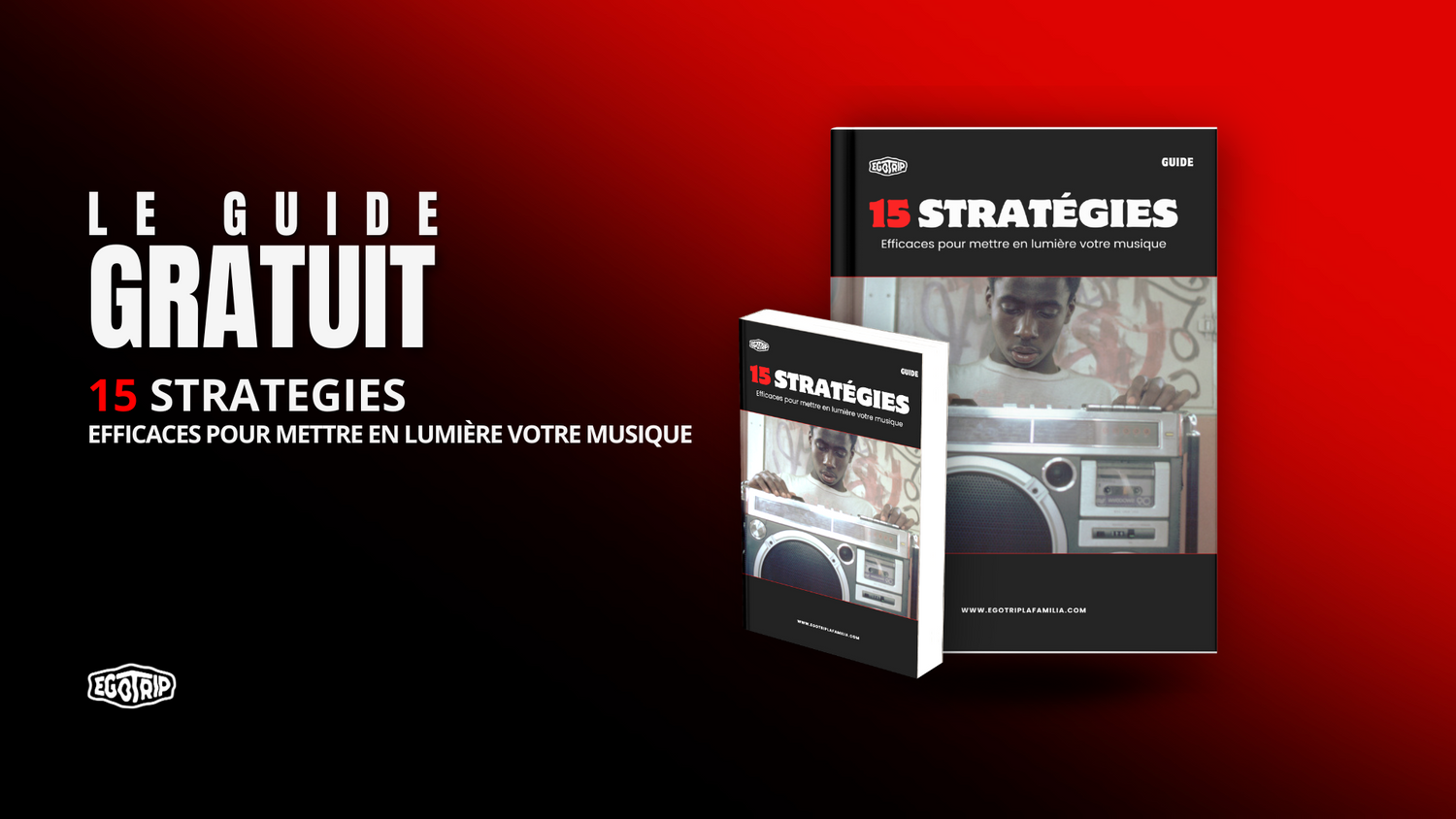Le 22 mars 2025, une décision de la Cour d’Appel des États-Unis a mis le monde artistique et technologique en ébullition : les œuvres entièrement générées par intelligence artificielle (IA) ne peuvent pas être protégées par le droit d’auteur. Une annonce qui pose une question de fond : quelle est la place de l’IA dans la création si ses productions ne bénéficient d’aucune protection légale ?
Une décision qui s’inscrit dans la continuité juridique
Le Copyright Act de 1976 stipule que seules les œuvres créées par des humains peuvent être protégées. Ce principe avait déjà été mis en avant dans plusieurs affaires, notamment en 2018 avec la célèbre "selfie du singe" (affaire Naruto v. Slater), où la justice avait conclu qu’un animal ne pouvait pas détenir de droits d’auteur.
Avec l’émergence des IA créatives comme Suno (musique), MidJourney (art visuel) ou ScriptBook (scénarios), la question s’est posée à plus grande échelle. Plusieurs demandes d’enregistrement d’œuvres générées par IA avaient déjà été refusées par le U.S. Copyright Office, et cette nouvelle décision de justice vient renforcer cette position : si une œuvre n’a pas bénéficié d’une intervention humaine significative, elle ne peut pas être protégée.
Un séisme pour les créateurs et l’industrie
Cette décision a des implications directes pour plusieurs secteurs artistiques :
Musique et arts visuels : De nombreux artistes et maisons de disques utilisent l’IA pour générer des morceaux, des pochettes ou des clips. Désormais, un titre entièrement produit par IA pourra être utilisé librement par n’importe qui.
Littérature et cinéma : Un scénario ou un roman écrit par une IA ne pourra pas être protégé, ce qui pourrait freiner les investissements dans ces technologies.
Le cas français : En France, où le marché de la musique a dépassé 1 milliard d’euros en 2024, cette décision risque d’influencer les pratiques. Les créateurs devront intégrer une part humaine dans leurs œuvres pour garantir leur protection.
Les startups et les plateformes face à un casse-tête
Les entreprises qui misent sur l’IA pour la création, comme Amper Music, Suno ou MidJourney, risquent de voir leur modèle économique fragilisé. Si leurs utilisateurs ne peuvent pas revendiquer la propriété de leurs œuvres, l’intérêt commercial de ces outils pourrait chuter.
Les plateformes de streaming comme Spotify pourraient aussi être submergées par des contenus IA non protégés, soulevant des questions : comment différencier une œuvre humaine d’une production automatisée ? Comment éviter les conflits avec les créateurs traditionnels ?
Un débat entre protection de l’art et innovation
La décision divise profondément la communauté artistique et technologique :
Les défenseurs du droit d’auteur (comme la RIAA, Recording Industry Association of America) applaudissent la mesure, estimant que la création humaine doit être protégée face à une production automatisée qui pourrait inonder le marché.
Les partisans de l’innovation dénoncent une approche rétrograde. Pour eux, l’IA est un outil créatif comme un autre, à l’image des synthétiseurs qui ont révolutionné la musique dans les années 80. Un développeur IA a résumé la frustration du secteur en déclarant sur X (ex-Twitter) : « Cette décision tue l’avenir de la création artistique. »
Quelles solutions pour les créateurs ?
Face à cette nouvelle réalité, les artistes et producteurs vont devoir s’adapter. Un beat électro généré par IA ne sera protégé que si une intervention humaine notable y est ajoutée (paroles, arrangements…).
À plus long terme, les législateurs pourraient être amenés à revoir le cadre juridique pour intégrer des protections spécifiques aux œuvres IA. Mais pour l’instant, la règle est claire : pas d’humain, pas de copyright.